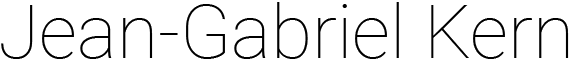Je suis retombé la semaine dernière sur une interview accordée en 2013 à The Telegraph, par Anders Bouvin, alors CEO de la banque suédoise Handelsbanken.
J’avais gardé ce document parmi d’autres, témoin d’une époque où je m’étais intéressé de près à cette entreprise hors-norme, dont la solidité financière impressionnait autant que son modèle managérial. Handelsbanken Svenska avait été profondément transformée dans les années 70, après une grave crise, par Jan Wallander – un des prédécesseurs de Anders Bouvin. Celui-ci avait fait le pari de redonner à cette banque son agilité, pari réussi qu’il raconte avec une sobriété toute nordique dans l’ouvrage Decentralisation – Why and how to make it work (SSNS Förlag, 2003).
Dans son interview de 2013, Anders Bouvin expliquait : « We have a process in the bank where branches decide the costs of the head office. They scrutinise our costs. If they are not happy with the service, they make sure the head office ups their game and, if not, they can go elsewhere. The branch manager is the king of the bank ».
Je passe sur le process évoqué, qui n’est pas l’objet de ce billet, et qui présenté tel quel, sans plus de détails, a de quoi interloquer. Ce qui m’a frappé, c’est l’expression employée : « The branch manager is the king of the bank » – « branch manager » désignant les patrons des quelques 800 succursales locales.
L’auteur de l’article commente : « Being “king of the bank” is not just a turn of phrase, but an accurate description of the extraordinary power that Handelsbanken invests in each of its local managers. Indeed, its corporate motto is “the bank is the branch”. (…) Managers have total authority within their local area to decide on every aspect of how the bank is run, handling everything from credit decisions to how much they should spend on advertising. In a banking industry in which the orthodoxy is that as many processes should be centralised as possible to cut costs, Handelsbanken has taken a diametrically opposite approach ». À titre d’illustration, 99% des décisions des décisions d’accorder un crédit se passe au niveau de la succursale, et la banque pourtant un des taux de défauts de crédit les plus bas du secteur.
En relisant ces lignes, je ne peux que penser à ce qui ressortait de mes échanges avec Philippe Pichlak, échanges dont je me suis fait l’écho dans mon article Fuel intitulé « L’alignement du management, mission impossible ? » Philippe dressait ce constat : « Le management intermédiaire, ce sont les mal-aimés des vingt dernières années. On a d’abord “strarifié”, “gourouifié” les patrons. Avec l’entreprise libérée, on a ensuite expliqué que les salariés étaient tous naturellement excellents et qu’ils ne devaient leur manque de performance qu’à la médiocrité de leurs managers. Résultat : on a complètement négligé, et même humilié, le management intermédiaire. Il suffit de regarder : quand un patron va dans une usine, il va taper sur l’épaule des ouvriers, remettre des médailles, saluer l’employé du mois. Mais la plupart du temps il n’a pas cinq minutes pour les managers de terrain et le patron du site. Tout ça c’est de la com’, pas du management. (…) Il faut arrêter de n’écouter que les salariés, et écouter un peu plus les managers. Les salariés peuvent te dire ce dont ils ont besoin, leurs problèmes, etc. mais ils n’ont pas de vision. (…) Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace de se mettre à l’écoute du management. Ils ont à la fois plus de hauteur de vue que les salariés et une meilleure connaissance du terrain que toi ».
Dans la foulée de cet article, nous avions organisés avec mes associés de La Boétie Partners une de nos « Zébuleries » où Philippe était venu illustrer son propos par le récit de son expérience à la tête d’un groupe de restauration. Poussé dans ses retranchements par les questions des participants, il avait alors été conduit à préciser sa pensée.
Quand il parlait d’écouter les managers, il visait en effet d’abord et avant tout ses patrons de restaurants – jusqu’ici mis en situation d’exécuter sans être beaucoup écoutés. Et d’expliquer : « Ce qu’il faut, c’est identifier l’échelon où se crée la valeur, la strate-pivot dans ton organisation. Et ce sont surtout ces gens-là qu’il faut écouter. Et les sortir de l’inféodation à ceux qui sont bien moins compétents qu’eux pour prendre certaines décisions de terrain ».
Dans les deux cas, ce qui me frappe d’abord, c’est qu’il est question de redonner de la voix, du pouvoir d’influence aux MANAGERS – là où le discours ambiant sur l’entreprise libérée parle des salariés.
Dans les deux cas, ce qui me frappe ensuite, c’est qu’il est question d’une même catégorie de manager : les PATRONS DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES, c’est-à-dire ceux qui, dans cette catégorie un peu fourre-tout appelée « management intermédiaire », sont ceux qui tiennent les « boutiques ». Anders Bouvin parle en effet de ses patrons de succursales ; mon ami Philippe fait lui référence à ses patrons de restaurants.
Dans les deux cas, ce qui me frappe enfin c’est la force des mots employés et le RÔLE-CLÉ assigné à cette strate managériale.
Je trouve intéressante cette idée de strate-pivot offrant le bon mixte entre « hauteur de vue » et « connaissance du terrain ». Et je trouve vertigineux que ce soit précisément cette strate qui, dans de nombreuses organisations, se sente aujourd’hui le plus pieds et poings liés.
Nombre de patrons opérationnels se sentent en effet pris en étau entre l’injonction de lâcher du pouvoir vis-à-vis des salariés et la réduction de leur sphère d’autonomie par les fonctions corporate. « Lâchez du pouvoir et exécutez ! » : programme alléchant !
Mon ami Philippe et Anders Bouvin signeraient sans doute des deux mains sur l’importance d’avoir des fonctions corporate solides, qui puissent jouer pleinement leur rôle, et des managers de terrain capables de jouer à fond le jeu de la confiance avec leurs troupes. Mais l’un et l’autre mettent le doigt, selon moi, sur l’un des grands points faibles de certains discours actuels sur la transformation des organisations.
Je vois bien de mon côté les milles bonnes raisons de dompter ou de serrer de près ces patrons opérationnels qui peuvent, dans certains cas, se transformer en « barons ». D’abord en faisant la pluie et le beau temps pour leurs équipes, qui se retrouvent ainsi parfois livrée au bon vouloir de boss abusifs. Ensuite en faisant obstruction aux projets de transformation qu’un dirigeant porte – à juste titre – pour son organisation, et qui supposent que ces patrons de terrain lâchent certaines choses. On a vu en effet plus d’un directeur régner en maître sur son magasin ou son usine, sans que les alertes remontant du terrain soient suffisamment entendues et prises au sérieux. On a vu plus, qui plus est, d’un projet s’enliser par la grève du zèle ou l’opposition sourde de ceux qui ont les clés du « barnum ». Ici, l’expression « king of the bank » peut faire craindre le pire…
Mais s’agit-il là vraiment de l’état d’esprit et du comportement de la majorité des patrons de terrain ? Leur rôle-charnière peut-il être ignoré, et avec lui leur sûreté de jugement et l’engagement dont ils font preuve pour faire réussir leur entreprise ? Et pourquoi leur refuser la confiance a priori largement vantée pour les salariés, au seul motif qu’ils auraient franchi le rubicon, et que leur entrée dans la catégorie « managers » en ferait des potentats en puissance ? étrange anthropologie à deux vitesses…
J’ai eu, avec mon associé Frédéric Haumonté, la chance de participer de près par le passé à deux projets de transformation d’entreprise au moment de la vague enthousiaste qui a suivi la publication d’ouvrages comme Employees first, Customers second de Vineet Nayar ou Liberté & Cie de Brian Carney et Isaac Getz.
Ces deux entreprises étaient de taille et de culture très différentes : moins de 200 salariés dans un cas, plus de 50000 dans l’autre ; secteur industriel dans un cas, secteur du retail dans l’autre. L’angle et la méthode étaient par ailleurs très différents dans ces deux situations.
Mais, dans ces deux cas, les choses ont achoppé, selon moi, sur une même difficulté : la cristallisation d’une opposition devenue quasi-insoluble entre la direction et les patrons opérationnels, confrontés à l’injonction paradoxale de lâcher et d’obéir, et insuffisamment entendus dans leurs bonnes raisons. À ce petit jeu-là, même les plus enthousiastes ont fini par être découragés… La direction aura ainsi perdu ses meilleurs alliés, ceux qui étaient le plus authentiquement désireux de s’inspirer de la bouffée d’air frais apportée par l’exemple inspirant des entreprises libérées. Pour ne rien dire de ceux qui avaient intérêt à ce que, surtout, rien ne change… et qui ont eu, eux de puissants alibis pour nourrir leur réticence !
La transformation d’une organisation est difficile, et bien malin celui qui en connaît les secrets. Mais je tire de ces expériences et de ces échanges le fait qu’elle ne peut s’opérer sans s’appuyer sur ceux qui, dans la vaste catégorie des managers intermédiaires, sont aux commandes des « boutiques », dans la zone de création de valeur.
Cela offre un solide garde-fou contre les illusions d’une autorité exercée de trop loin, y compris lorsqu’elle est animée par les meilleures intentions du monde. On ne s’affranchit en effet jamais sans dommages des corps intermédiaires, malgré tous les reproches qu’on peut leur faire et malgré leurs travers exaspérants… C’est un principe fondateur de l’état de droit lorsqu’il entend éviter de partir de travers, et il me semble donc aventureux de vouloir s’en affranchir.
J’y vois par ailleurs une clé pour sortir des discours clivants et simplificateurs qui opposent le corporate et le terrain d’une part, les salariés et leurs managers d’autre part. Et qui conduisent dans une impasse. Car, si le rôle-charnière des patrons opérationnels est annonciateur de blocages potentiels, il est surtout porteur de solutions pour réussir la synthèse entre ces réalités en tension. Car ces patrons incarnent justement la tension inévitable entre la tête et les jambes, et vivent au quotidien la difficulté de faire tenir ces réalités. Il y a donc beaucoup à apprendre en les écoutant. Quitte à le nettoyer de ce que cela comporte de mauvaise foi – nous en avons tous un peu -, d’excès dus à l’exaspération, ou de manque de lucidité.
Ces tensions qui les traversent au quotidien expliquent sans doute en partie leurs comportement de grognards napoléoniens, fidèles pour la plupart, mais pas toujours simples à gérer. Mais quel général serait assez fou pour ne pas s’appuyer sur ses grognards ?
Source :
https://www.laboetiepartners.com/lalignement-du-management-mission-impossible/